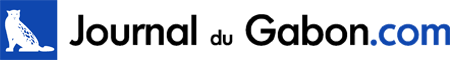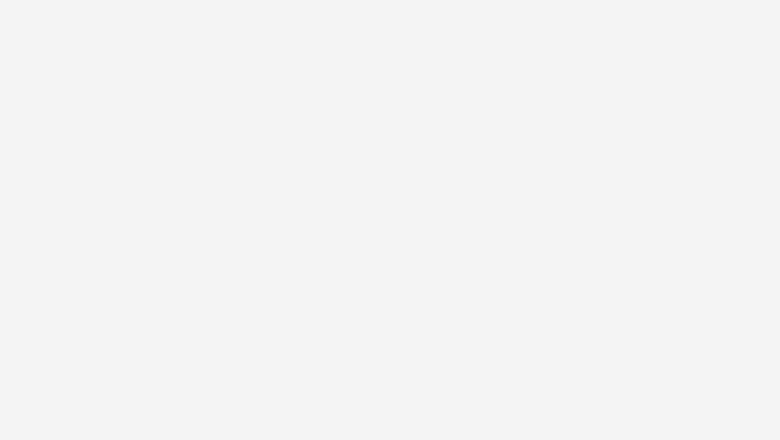Dix jours après la chute d’Ibrahim Boubacar Keïta, Apa News a rencontré, à Bamako, le célèbre Imam Dicko dont le rôle a été déterminant dans la mobilisation populaire qui a provoqué le coup d’État militaire contre le président déchu.Les orateurs qui l’ont précédé ont tous pu parler sans vraiment être interrompus, sauf parfois par quelques applaudissements. Mais quand Mahmoud Dicko se lève pour se diriger vers le pupitre d’où il doit prononcer son discours, il lui faut du temps pour que le public le laisse parler. « Allahou Akbar, Allahou Akbar, Dicko, Dicko » s’époumonent longuement les milliers d’auditeurs. « Sabali, Sabali » (pardon, pardon, en bambara, la langue la plus parlée au Mali), prie-t-il plusieurs fois. Un exercice qu’il est d’ailleurs contraint de répéter tout au long de cette première intervention publique qu’il tient depuis la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), le 18 août dernier, suite à un coup d’État militaire.
C’était vendredi 28 août, en milieu d’après-midi, lors d’un meeting dans la grande salle du palais de la Culture de Bamako organisé par ses partisans, fers de lance du M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques). Cette coalition de partis politiques, d’activistes civils et de religieux qui, début juin, avait lancé le mouvement de protestation massif réclamant le départ d’IBK, finalement « démissionné » par l’armée.
LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ
À 66 ans, le religieux « le plus célèbre du Mali » ne se réjouit pas particulièrement de ce qui est arrivé à son « ami et frère », comme il continue à désigner le président déchu. Il ne regrette pas non plus le coup d’État qui l’a déposé, le quatrième de l’histoire moderne de cette ancienne colonie française d’Afrique de l’Ouest indépendante depuis 1960.
L’Imam, qui avait pourtant fortement aidé IBK à arriver au pouvoir pour la première fois en 2013, avant de s’en éloigner, estime que « vu son bilan et la situation du pays, l’intervention des jeunes officiers pour obliger IBK à quitter le pouvoir est un acte salutaire. Autrement, le pays allait droit dans le mur », explique-t-il, plus tard dans la soirée, installé dans sa modeste maison attenante à la mosquée où il officie depuis plusieurs dizaines d’années dans le quartier de Badalabougou, à deux pas du palais de la Culture.
« Je l’ai absolument soutenu lors de sa première élection en 2013. À l’époque, j’étais convaincu que c’était l’homme qu’il fallait au Mali pour ramener la paix et mettre le pays sur les rails », explique l’imam en allusion au contexte où se trouvait son pays à la veille de la première élection d’Ibrahim Boubacar Keïta comme président de la République. C’était en septembre 2013. À l’époque, le Mali venait de vivre un des moments les plus critiques de son histoire moderne, suite à une énième rébellion nationaliste touarègue survenue en janvier 2012 dans le nord du pays. Celle-ci a finalement été rapidement supplantée par des groupes jihadistes liés à Al-Qaida. Durant une dizaine de mois, ces derniers avaient érigé un mini État islamique dans cette partie du Mali grande comme deux fois la France où l’unique loi était la charia (loi islamique), coupant les mains des voleurs, lapidant les couples accusés d’adultère, etc.
Une intervention des militaires français, appuyée par quelques pays africains, a permis de chasser, à partir de janvier 2013, les islamistes des villes qu’ils occupaient jusqu’alors. Mais le septentrion malien reste à ce jour loin d’avoir été pacifié. Les agents des services publics, les représentants de l’administration et les forces de sécurité, censés signifier le retour de l’État dans la région, n’y sont toujours pas déployés, sauf dans des cas très rares et la violence s’est d’ailleurs étendue à d’autres régions du pays.
« IBK a été élu sur des promesses claires, comme la lutte contre la pauvreté, le retour de la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Aucune de ces promesses n’a aujourd’hui été tenue. Les Maliens souffrent toujours de la pauvreté, de la corruption, de la gabegie et les détournements des biens publics ont atteint des niveaux jamais vus. Le pays n’a pas été réunifié, la paix n’est jamais revenue et l’insécurité s’est d’ailleurs étendue à une grande partie du pays où les communautés s’entretuent », accuse-t-il.
Le religieux, qui s’est toujours distingué parmi les élites maliennes défendant l’idée de négociations avec les islamistes armés, est-il encore disposé à intercéder entre les nouvelles autorités de Bamako et les rebelles islamistes ?
Mahmoud Dicko connaît très bien les leaders maliens du principal groupe d’insurgés islamistes actif au Mali : le Groupe pour le soutien de l’Islam et des Musulmans ((GSIM, connu aussi par son acronyme en langue arabe JNIM), allié à Al-Qaida, le Touareg Iyad Ag Ghali et le Peul Amadou Koufa dont les hommes sont très actifs respectivement dans le nord et le centre du pays.
« Ils sont Maliens non ? Ce sont des fils de ce pays et on doit bien évidemment leur tendre la main. La violence n’a jamais rien réglé. Je ne cache pas que je suis bien partisan d’une discussion avec eux. Si on me le demande, je suis prêt à aller les voir. La paix dans mon pays vaut bien tous les efforts que je peux faire », justifie le religieux.
La junte désormais au pouvoir doit entamer incessamment des concertations avec les « forces vives de la nation » pour déterminer les modalités d’un rétablissement de l’ordre constitutionnel, après la démission forcée du président IBK et la dissolution de l’Assemblée nationale. L’Imam est-il intéressé par une participation au gouvernement de transition qui sera bientôt mis en place ?
« Je ne serai jamais candidat à aucun poste politique. Même si on m’oblige, je ne serai jamais président du Mali. Je suis Imam et je reste Imam », jure t-il, précisant que « cela ne veut pas dire que je ne vais pas intervenir dans le débat public quand cela se justifie ».
Mahmoud Dicko, qui aime répéter qu’un « Imam est aussi un citoyen ayant forcément un avis comme tout Malien », partage-t-il le point de vue de la nouvelle junte qui souhaite engager une transition politique de trois ans ? Un délai jugé trop long par une bonne partie des Maliens et surtout par la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), à laquelle le Mali est affilié. Mandatée par la communauté internationale pour négocier avec les militaires un agenda destiné à conduire le pays vers des élections législatives et présidentielle dans un « délai raisonnable », l’organisation régionale, qui a décidé de sanctionner les nouvelles autorités en fermant toutes les frontières avec le Mali, plaide pour une transition qui ne dépasse pas un an.
« Trois ans, c’est trop long. Un an, c’est trop court. Quand on analyse objectivement la situation dans laquelle se trouve le Mali, je crois que l’idéal serait une transition de 18 mois. C’est assez suffisant pour faire l’état des lieux du pays et choisir la voie consensuelle dans laquelle le Mali doit s’engager. C’est juste une question de raison », plaide t-il.
Préfère t-il un président de transition civil ou militaire ? « Si cela dépend de moi, une personnalité civile intègre et respectée est le meilleur choix. Mais les militaires ont tout de même le droit de participer au gouvernement de transition. Ils ont joué un rôle important en parachevant cette révolution populaire que nous avons lancée en juin. Ils ont donc le droit de participer à la gestion de la période de transition, surtout qu’ils sont aussi Maliens comme nous autres civils », explique t-il.
Mahmoud Dicko que ses détracteurs accusent de travailler pour l’avènement d’une « république islamique au Mali », souhaite t-il que la nouvelle transition débouche sur des réformes qui accordent plus de place à l’Islam dans la Constitution et les lois du pays ?
« Très honnêtement, j’estime que la question ne se pose pas aujourd’hui au Mali. Même si nous sommes à 99% musulmans, ce n’est pas une priorité pour les Maliens d’évoquer la laïcité ou la question religieuse. J’estime que tout le monde a sa place dans ce pays. Personnellement, j’ai les meilleures relations possibles avec toutes les obédiences religieuses, et je l’ai même répété plusieurs fois aujourd’hui devant le public », dit-il en allusion aux hommages appuyés qu’il a rendus quelques heures plus tôt devant ses partisans aux autres chefs religieux musulmans et à l’archevêque de Bamako. « C’est mon frère et il le sait très bien. Ce n’est pas de la langue de bois », insiste-t-il.
« L’urgence pour le Mali est de retrouver un pays normal, avec un président et un gouvernement intègres, honnêtes et qui travaillent pour l’intérêt national et surtout le retour de la paix et la réconciliation nationale. Le reste est secondaire », défend celui qui aujourd’hui invite « la jeunesse malienne à rester vigilante » et promet que « plus personne n’aura jamais un chèque en blanc pour diriger le Mali ».
S’adresse t-il au futur président élu ou à la junte actuellement au pouvoir aussi ?
« Je m’adresse aux deux et je mets d’ailleurs en garde les jeunes officiers au pouvoir actuellement contre la tentation d’une gestion solitaire des affaires », assume l’Imam qui s’est rendu initialement célèbre au Mali en défiant un autre pouvoir : celui du président Amadou Toumani Touré (ATT), élu en 2002 mais renversé en 2012 par de jeunes militaires. C’était en 2007 lorsque le religieux avait mobilisé des milliers de Maliens dans le grand stade de Bamako obligeant ATT à retirer un projet du Code de la famille censé alors accorder plus de droits aux femmes.
L’Imam, qui a dirigé le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM) de janvier 2008 à avril 2019, est aujourd’hui considéré comme le « religieux le plus populaire et l’homme public malien le plus influent ». Actuellement à la tête d’une Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (Cmas), un groupe à mi-chemin entre l’action religieuse et la politique, l’Imam est de l’avis de tous l’un des rares hommes publics maliens dont l’avis est incontournable dans bien des domaines.
Ce natif de Tombouctou en 1954, issu d’une famille de lettrés musulmans, est le fils d’un érudit peul et d’une femme arabe appartenant à la très réputée tribu des Kountas considérés comme les dépositaires de la voie soufie de la Kadririya dans le Grand Sahara et l’Afrique de l’Ouest.
Après un apprentissage initial du Coran et de la langue auprès de sa famille et de grands maîtres de sa région natale au Mali, il se rend en Mauritanie alors qu’il a à peine seize ans. Installé à Boutilimit, petite cité en plein désert située à 150 kilomètres à l’est de Nouakchott, la capitale, il s’y inscrit à l’Institut des études islamiques, le premier établissement du genre fondé en Afrique de l’Ouest qui dispose alors d’un double programme scolaire moderne et religieux. Cet établissement, dont la réputation à l’époque dépasse déjà largement la sous-région, accueillait des étudiants venant du monde entier, y compris des Occidentaux.
L’un d’entre-eux, un Français plus ou moins connu alors dans le monde du cinéma pour ses choix « bruts et sauvages » devient son ami : Serge Bard, rebaptisé Abdullah Siradj après sa conversion à l’Islam à la fin des années 1960 lors d’un voyage en Algérie. Fondateur du collectif « Zanzibar », Bard a déjà trois films à son actif : Ici et maintenant, en mars et avril 1968, Détruisez-vous (Le Fusil silencieux) et Fun and Games for Everyone, film dont Henri Alekan signe la photographie.
« J’étais très jeune. À l’époque, il n’y avait ni routes, ni transports, ni papiers d’identité. J’ai traversé toute la Mauritanie à l’ancienne. À la nomade. À dos de chameaux. J’ai été à Oualata, Nema, Timbedra, Aioun, Kiffa, et enfin Boutilimit. C’était magnifique. J’ai beaucoup appris là-bas. J’y ai rencontré de vrais maîtres mais aussi d’excellents élèves et étudiants dont je garde le meilleur des souvenirs comme mon ami français Abdulah Siradj ».
Après son séjour en Mauritanie, Mahmoud Dicko se rend en Arabie saoudite, où il s’inscrit à la célèbre université de Médine, considérée comme le grand centre de diffusion de l’Islam wahhabite. La doctrine officielle du royaume des Saoud. S’est-il converti à ce courant lors de ce séjour ?
L’Imam Dicko, qui par le passé s’était déclaré publiquement « wahhabite », ne le dit plus. Ses amis qui aiment rappeler son opposition « radicale à toute violence » préfèrent le décrire comme « un simple musulman » ou un « islamiste centriste ( c’est-à-dire modéré) sinon « un salafiste quiétiste comme tant d’autres de même obédience ».